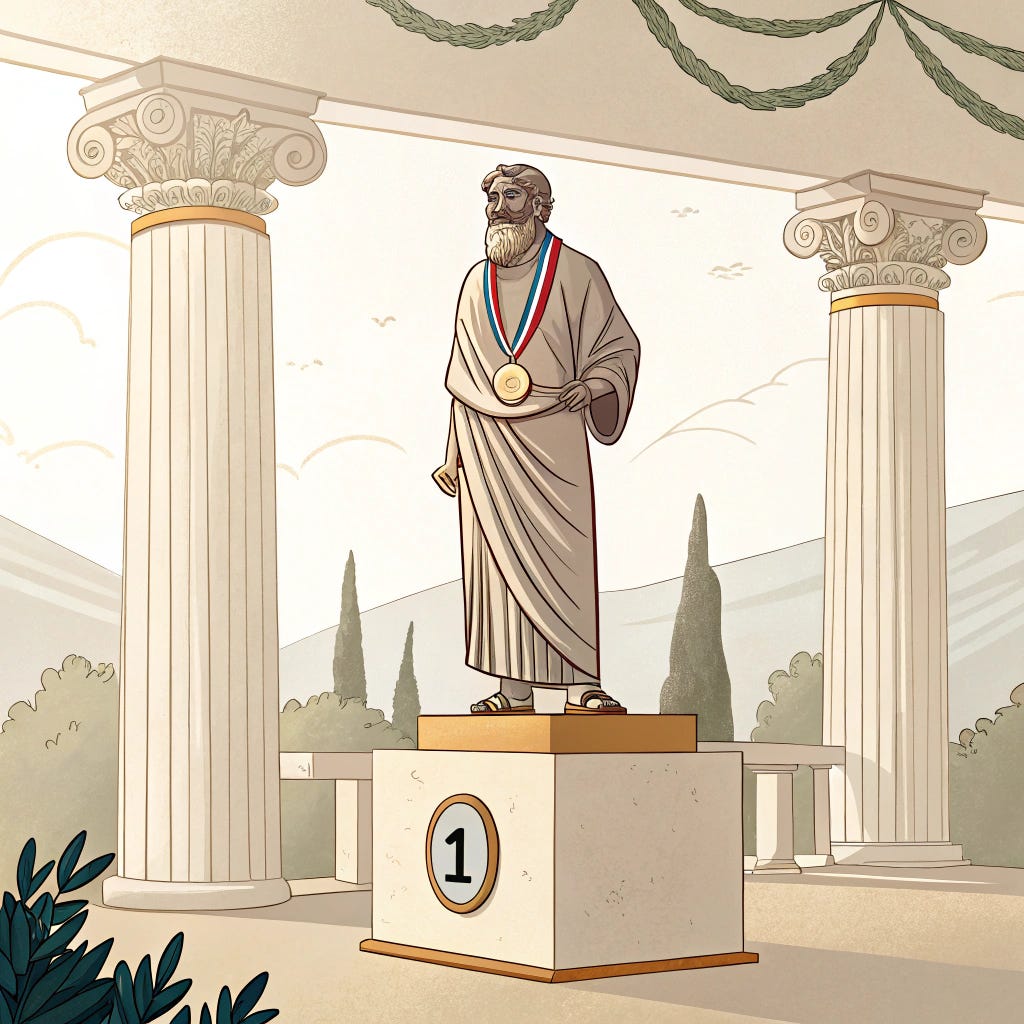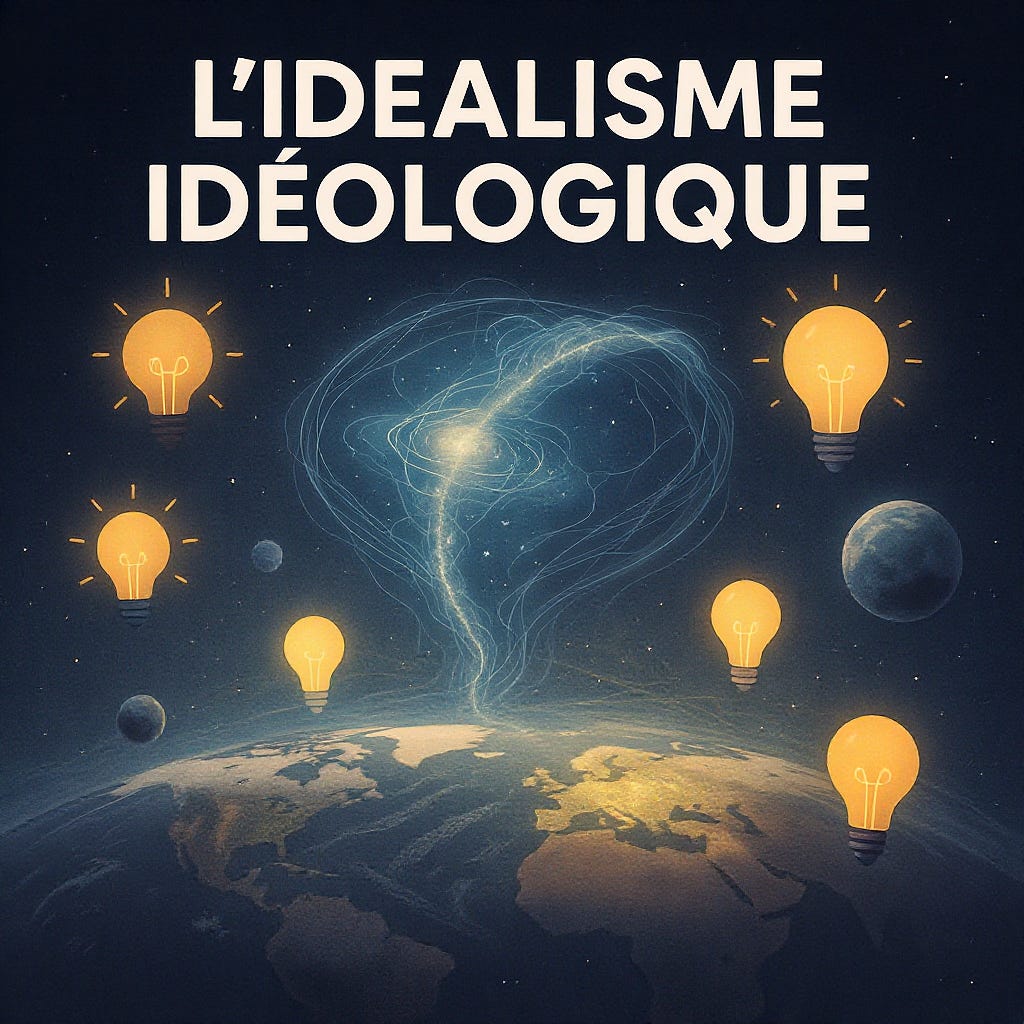Erotikos #1 : La question fondamentale du désir
Pourquoi sommes-nous devenu une société d’eunuques ?
Cet article parlera des mécanismes du désir, de l’importance d’accepter la souffrance du manque, de l’Homme Faustien et de bien plus… Pour ceux qui s’attendraient à autre chose, nous ne parlerons pas directement de cul ici. Je publierai plutôt quelques pièces de fictions pour aborder ce genre de choses
Platon avait raison
Oh que ce titre fait mal pour quelqu’un portant le doux nom de Calliclès et qui se veut très souvent être un fervent défenseur de Nietzsche. Et pourtant, je le dis, Platon a totalement raison sur la nature du désir. Pour lui, je cite, “Ainsi désirer dans ce cas, comme toujours, c'est désirer ce dont on n'est pas sûr, ce qui n'est pas encore présent, ce qu'on ne possède pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque;” (Le Banquet, [200e]). En l’espèce on ne peut désirer que quelque chose que l’on a pas en sa possession et dont on ne peut pas jouir. Je suis sûr que nombreux d’entre vous avez tout un tas de bons arguments pour me soutenir que cette définition est totalement fausse et biaisée. Je vous avoue que pourtant elle me sert de grille de lecture pour beaucoup d’événements, sur le comportement des autres et de moi-même (de toute manière c’est la bonne définition, on me l’a dit dans un rêve).
Derrière tout ce qui nous porte, toutes nos actions ardemment poursuivies ou lamentablement échouées, il y a toujours la poursuite de quelque chose que l’on a pas. Selon moi, un Homme accompli c’est quelqu’un qui court intensément derrière l’objet de son désir et qui prend son accomplissement, parfois même son assouvissement, comme une pause bien méritée avant de repartir chasser son désir prochain. C’est une vision de la vie plutôt amorale (mais pas forcément immorale), parfois cynique et surtout presque toujours égoïste. Et j’adore ca. Regardez derrière vous les objets de vos grands désirs : vous verrez l’élan inconsidéré que vous avez dépensé pour essayer de les atteindre; les risques grands et l’énergie inépuisable que vous avez eu à ce moment là. Car là est la grande loi du désir, et sans doute la raison pour laquelle le désir est si peu exploré en philosophie : le désir est autokinétique, transitoire, inconsistant et fluctuant. Pour un oeil non averti il représente le chaos et l’incertitude, mais quand on prend un peu de recul on se rend vite compte que toutes les grandes oeuvres humaines ont été portées par des désirs.
L’illusion du bonheur comme état de contentement
On ne peut passer à coté de ce constat : notre société porte le bonheur en étendard. Elle porte le bonheur comme étant la finalité historique et téléologique de la vie. Les rayons livres débordent de développement personnel (qui parfois donne quand même de bons conseils) et le “feel good” est devenu une catégorie littéraire à part entière. Si nous prenons les arguments de la première partie, le bonheur humain serait alors à l’opposé du désir : le bonheur est durable, apaisant, imperturbable et défini. Il est d’ailleurs un exemple parfait de ce qui est marketable… Qui peut s’opposer au contentement durable et imperturbable ? Etes-vous fou ou même maso ?
Et bien moi je n’y crois pas, pas du tout même. Je pense que le bonheur est un vieux pieux mais immensément faux et qui peut nous mener à de mauvais ports. Le bonheur nous vend du rêve mais je pense qu’on peut gâcher une vie précieuse à le définir complètement et à le chercher, sans jamais vraiment le trouver. C’est quelque chose qui nous rassure que de nous dire qu’un assouvissement perpétuel du désir est possible : on se sent porté par cette image. Mais la vérité brutale et crue est tout autre : le bonheur n’existe pas et vous perdrez un temps précieux sur cette terre à vouloir l’atteindre. Ce qui je pense gâche la vie de beaucoup et de notre politique se base même sur cela : c’est ce que j’appelle l’idéalisme idéologique
.
Les réponses idéologiques au désir
Les Hommes sont alors rapidement et indéfiniment confrontés à la souffrance du désir. Un désir qui est sans cesse renouvelé sans répit ni sens. Face à cela, des panacées sont construites. Elles proposent une réponse à la question du bonheur, avec un accomplissement total du désir sur cette terre ou ailleurs. Politiquement cela s’illustre par l’utopie; qu’elle soit communiste ou conservatrice (voire réactionnaire). Elle propose et vend une solution “fin du game” où rien n’est plus à améliorer : une solution parfaite qui ne requiert aucun désir de changement. A cela j’oppose personnellement un progressisme, de droite évidemment, qui prend en compte la nature tragique du désir : un mode de gouvernement pragmatique qui ne cesse de vouloir accomplir ses désirs mais comprend que ce moteur n’a pas de fin. J’aurais l’occasion de développer cette vision du progressime de droite dans de futurs articles.
Dans les idéologies religieuses, le bonheur est accompli le plus souvent dans l’après-vie. L’Homme serait confronté à la souffrance de l’existence (principalement par un désir contrarié) pour goûter au bonheur après-vie. N’ayez crainte, je ne veux pas développer une vision simpliste et diabolisée de la religion, je simplifie et prends les grands principes de ces visions métaphysiques. Le souci étant que certains de ces mouvements nient la nature totalisante du désir : on pourrait selon eux nier ou éteindre cette force désirante et on en serait alors récompensé par un état de contentement absolu.
Une mention honorable dérogeant à la règle est le bouddhisme : même si je pense que sa solution est nihiliste (le nirvana par annhiliation de toute existence et donc du désir) il part d’une définition correcte de ce désir. Je pourrais développer un article entier sur le sujet mais pour le résumer : le bouddhisme comprend que le désir est fluctuant et que son contentement ne peut être que provisoire et illusoire. De même il définit ce désir comme étant l’explication principale de nos souffrances. C’est pour moi la définition la plus juste donnée par une idéologie de masse.
Supériorité de l’Homme Faustien Européen
En guise de conclusion, je voudrais développer un point qui me semble essentiel et qui pourra être argumenté à l’avenir. La prise en compte du désir comme moteur primaire de l’Homme doit encore être développé, et de par sa conclusion “progressiste” nous ne pouvons pas dire qu’une forme totale de cette compréhension a été développée dans le passé : il reste l’avenir pour illustrer et mettre en action les conclusions de ce concept !
Mais si je devais dégager une tendance qui comprend le mieux cette définition : ce serait l’Homme Faustien Européen. Un homme qui serait en quelque sorte le mieux illustré par Faust, ou par Ulysse. Ulysse comprend l’importance totale du désir et sa force redoutable : par l’épisode des sirènes il illustre aussi le fait que le contentement complet de ce désir (par le bonheur éternel offert par les sirènes ou par Circé) est une illusion et qu’elle est plus que dangereuse. Il faut de même comprendre comme lui que nous avons plus que besoin du désir pour avancer, surtout à notre époque stérile, mais qu’il ne faut pas non plus imaginer que le contentement éternel et parfait du désir soit possible.
J’imagine Ulysse enchainé au bateau, entouré de sirènes séductrices, profitant du feu ardent sans pour autant succomber à une illusion du bonheur qui le tuerait entre les mains de femmes mythologiques redoutables.
Pour reprendre les propos d’Albert Camus : il faut imaginer Ulysse heureux, tourmenté par les tentations des sirènes mais heureux du désir absolu qui le brûle !